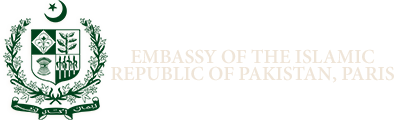Par Imran Khan, Premier ministre du Pakistan
En regardant les auditions au Congrès américain au sujet du retrait d’Afghanistan, j’ai été frappé de voir que les sacrifices du Pakistan, allié des États-Unis dans la guerre contre le terrorisme pendant plus de deux décennies, n’ont pas été mentionnés. Au lieu de cela, nous avons été blâmés pour la débâcle américaine.
Soyons clairs, je n’ai eu de cesse de répéter depuis 2001 que la victoire n’était pas acquise en Afghanistan. Compte tenu de leur histoire, les Afghans n’auraient jamais accepté le déploiement à long terme de forces militaires étrangères sur leur territoire, et aucun pays, y compris le Pakistan, n’était en mesure d’infléchir cela.
Malheureusement, les gouvernements qui se sont succédé au Pakistan après le 11-Septembre ont tenté de se concilier les bonnes grâces des Américains au lieu de souligner les limites d’une approche purement militaire. En quête insatiable de légitimité nationale et internationale, le dictateur militaire pakistanais Pervez Musharraf a systématiquement accordé aux États-Unis le soutien militaire exigé après le 11-Septembre. Cela a coûté cher à Islamabad comme à Washington.
Parmi les groupes ciblés par le Pakistan à la demande des États-Unis figuraient ceux entraînés par la CIA et notre agence de renseignement, l’ISI, pour vaincre les Soviétiques en Afghanistan dans les années 1980. À l’époque, ces moudjahidines afghans étaient salués comme des combattants de la liberté, accomplissant un devoir sacré. Le président Ronald Reagan les a même reçus à la Maison-Blanche.
Une fois les Soviétiques vaincus, les États-Unis ont quitté l’Afghanistan et sanctionné mon pays, laissant derrière eux plus de 4 millions de réfugiés afghans fuir vers le Pakistan alors qu’une guerre civile sanglante éclatait en Afghanistan. Ce vide sécuritaire a donné naissance aux talibans, dont beaucoup ont vu le jour et ont été éduqués dans des camps de réfugiés afghans au Pakistan.
Revenons à l’après 11-Septembre, lorsque les États-Unis ont de nouveau fait appel à nous — mais cette fois contre ceux-là mêmes que nous avions soutenus conjointement pour lutter contre l’occupation soviétique. Pervez Musharraf a mis à disposition des Américains des bases logistiques et aériennes, autorisant la CIA à opérer au Pakistan, allant jusqu’à fermer les yeux sur les drones américains qui bombardaient des citoyens pakistanais sur notre territoire. Pour la première fois, notre armée a envahi les zones tribales semi-autonomes situées à la frontière entre le Pakistan et l’Afghanistan, qui avaient auparavant servi de base au jihad antisoviétique. Les tribus pachtounes de ces régions, farouchement indépendantes, ont tissé des liens ethniques profonds avec les talibans et d’autres militants islamistes.
Pour elles, les États-Unis tout comme les Soviétiques étaient des « occupants » en Afghanistan et ils méritaient le même traitement. Le Pakistan, rangé derrière les États-Unis, a à son tour été jugé coupable et attaqué. Cette situation, aggravée par les quelque 450 frappes de drones américaines sur notre territoire, a fait de nous le seul pays au monde à être ainsi bombardé par un allié. Ces tirs ont causé de nombreuses victimes parmi les civils, attisant le sentiment antiaméricain (et le rejet de l’armée pakistanaise).
La situation rendait tout retour en arrière impossible. Entre 2006 et 2015, une cinquantaine de groupes militants islamistes ont déclaré le jihad contre l’État pakistanais, perpétrant plus de 16 000 attaques terroristes à notre endroit. Ce conflit a coûté la vie à plus de 80 000 Pakistanais, tandis que les pertes économiques du pays se sont élevées à plus de 150 milliards de dollars. Par ailleurs, 3,5 millions de nos citoyens ont dû fuir leur foyer. Certains militants, passant entre les mailles du filet pakistanais, ont réussi à rejoindre l’Afghanistan. Soutenus et financés par les services de renseignement indiens et afghans, ils ont multiplié les attaques contre nous.
Le Pakistan a dû lutter pour sa survie. Comme l’écrivait en 2009 un ancien chef de station de la CIA à Kaboul, le pays « commençait à craquer sous la pression incessante exercée directement par les Américains ». Pourtant, les États-Unis nous demandaient sans cesse d’intensifier nos efforts pour la guerre en Afghanistan.
Un an plus tôt, en 2008, je rencontrais Joe Biden, John F. Kerry, Harry M. Reid et d’autres sénateurs pour leur exposer cette dynamique dangereuse et souligner la futilité de l’intervention militaire en Afghanistan.
Malgré cela, l’opportunisme politique a prévalu à Islamabad tout au long de la période de l’après 11-Septembre. Le président Asif Zardari, sans doute l’homme le plus corrompu à avoir dirigé mon pays, a dit aux Américains de continuer à cibler les Pakistanais parce que « les dommages collatéraux vous inquiètent, vous les Américains, mais ils ne m’inquiètent pas. » Nawaz Sharif, le Premier ministre du gouvernement suivant, était du même avis.
Le Pakistan avait en grande partie contré les offensives des terroristes en 2016. Néanmoins, la situation continuait de se détériorer en Afghanistan, comme nous l’avions prédit. Pourquoi un tel écart ? Le Pakistan disposait d’une armée et d’un service de renseignement disciplinés, qui bénéficiaient tous deux du soutien populaire. En Afghanistan, le manque de légitimité des troupes étrangères déployées depuis longtemps dans le pays était aggravé par un gouvernement afghan corrompu et inepte, perçu par les Afghans, notamment dans les zones rurales, comme un régime fantoche sans crédibilité.
Au lieu d’affronter cette réalité, les gouvernements afghan et occidentaux ont préféré créer un bouc émissaire commode en rejetant la faute sur le Pakistan, nous accusant à tort de fournir des sanctuaires aux talibans et de leur permettre de circuler librement à travers notre frontière. Si tel avait été le cas, les États-Unis n’auraient-ils pas mené certaines des quelque 450 frappes de drones contre ces supposés sanctuaires ?
Pourtant, pour satisfaire Kaboul, le Pakistan a proposé un mécanisme conjoint de visibilité frontalier, suggérant, entre autres, des vérifications biométriques et préconisant d’ériger une clôture le long de la frontière (tâche menée à bien quasiment sans aide extérieure). Toutes nos idées ont été rejetées. Au lieu de cela, le gouvernement afghan n’a pas manqué une occasion de « blâmer le Pakistan », appuyé par l’Inde et ses réseaux de désinformation ramifiés à des centaines d’organes de propagande dans de nombreux pays.
Il aurait été plus réaliste de négocier avec les talibans plus tôt, en évitant l’embarras de la déroute des troupes afghanes et de l’effondrement du gouvernement d’Ashraf Ghani. Le Pakistan n’est certainement pas responsable du manque de motivation de l’armée afghane et de ses 300 000 soldats entraînés et armés face à des talibans sous-équipés. Le problème de fond était que la structure gouvernementale afghane manquait de légitimité aux yeux des Afghans.
Aujourd’hui, alors que l’Afghanistan se trouve de nouveau à la croisée des chemins, nous devons nous tourner vers l’avenir pour prévenir un autre conflit violent dans ce pays, plutôt que de ressasser de sempiternels reproches.
Je suis convaincu que la communauté internationale gagnerait à s’engager aux côtés du nouveau gouvernement afghan pour assurer la paix et la stabilité — ses attentes portent sur l’inclusion des principaux groupes ethniques dans le gouvernement, le respect des droits du peuple afghan et la promesse que le territoire afghan ne sera plus jamais utilisé par des terroristes contre quelque pays que ce soit. Les dirigeants talibans auront davantage de raisons et de moyens de tenir leurs promesses s’ils sont assurés de recevoir l’aide humanitaire et au développement requise pour diriger efficacement le pays. En outre, l’octroi de telles incitations offrirait un levier supplémentaire pour pousser les talibans à honorer leurs engagements.
En appliquant ces principes, nous pourrions aboutir à ce que le processus de paix de Doha visait depuis le début : un pays, l’Afghanistan, qui ne constitue plus une menace pour le monde, où les Afghans peuvent enfin rêver de paix après quatre décennies de conflit. L’alternative — l’abandon de l’Afghanistan — a déjà été tentée. Comme dans les années 1990, elle conduirait inévitablement à l’effondrement, avec pour corollaires naturels le chaos, les migrations massives et une menace renouvelée de terrorisme international. Éviter cela doit être un impératif à l’échelle mondiale.
(Publié dans le Washington Post le 27 septembre, 2021)
*****